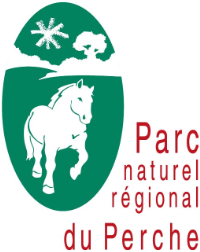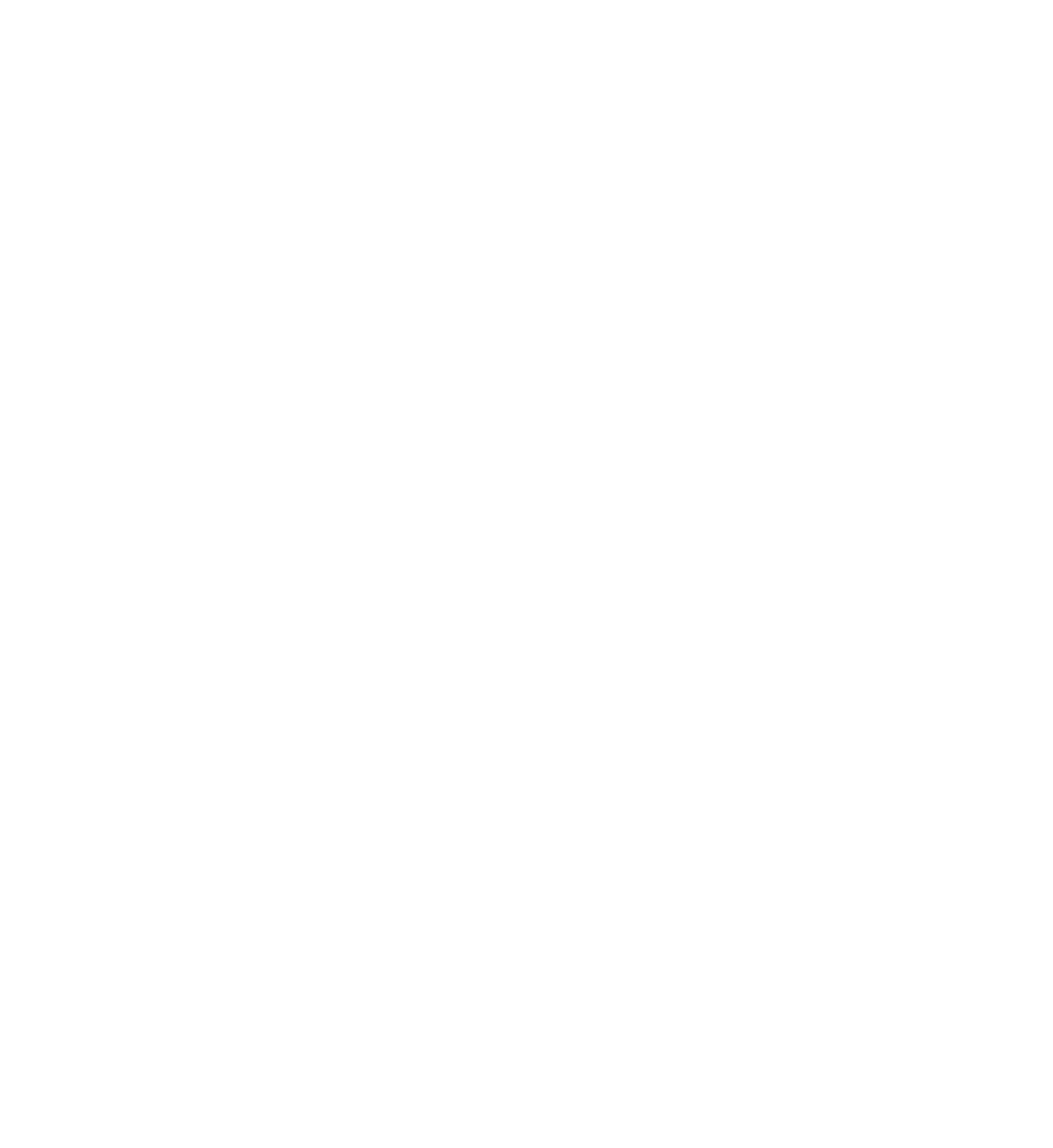L’année 2017 a vu la poursuite des inventaires ornithologiques de la Zone de protection spéciale des forêts et étangs du Perche. Les chargés d’étude du Parc ont investigué 3 115 des 47 000 hectares de ce vaste site Natura 2000 en archipel, couvrant l’essentiel des forêts du Perche, et où ils ont « contacté » pas moins de 123 espèces d’oiseaux différentes, auxquelles s'ajoutent 7 espèces de migrateurs récemment observées. Voici un zoom sur certaines de ces espèces, que vous pourrez aussi toutes retrouver dans la liste à télécharger en bas de cette page.
Cette étude est financée par l'Etat et l'Europe
dans le cadre de Natura 2000.
Engoulevent d’Europe
L’Engoulevent d’Europe traverse le Sahara deux fois par an pour venir nicher en Europe. C’est un migrateur très discret qui niche au sol dans les landes ouvertes sèches ou les jeunes parcelles de régénération forestière. Son plumage est dit « cryptique » : il le rend quasiment invisible lorsqu’il est posé au sol, se confondant avec la végétation.
Oiseau crépusculaire et actif en première partie de la nuit, c’est à ce moment qu’on le recherche, guettant son chant semblable, selon certains, à un bruit de moteur de mobylette pouvant se prolonger jusqu’à 10 minutes sans interruption ! Il arrive dans nos régions dès la fin avril et ne repart qu’en septembre.
L’espèce est principalement menacée par la perte de son habitat : le reboisement de landes ou, ailleurs, l’urbanisation sont les principaux facteurs de déclin. Les travaux sylvicoles en période de reproduction ou la prolifération de sangliers dans certaines régions nuisent également au succès de la reproduction de l’engoulevent (de même qu’aux autres espèces nichant au sol).
Pic Cendré
Le Pic cendré est un oiseau très discret, s’enfuyant en silence ou se camouflant à merveille dans les frondaisons au moindre dérangement. Cette espèce est monogame et un couple occupe un vaste territoire. En dehors de la saison de reproduction, et comme d’autres pics, cet oiseau redevient strictement solitaire. Tout cela peut contribuer à expliquer le peu d’observation de cet oiseau dans un massif forestier.
Ce caractère discret rend son observation, et donc son comptage, difficile : aucun « contact » n’a pu être établi cette année. On s’accorde à penser qu’il est en forte régression dans les massifs constituant les bastions de l’espèce dans l’ouest (Fontainebleau, Bretagne, Ecouves). Le Perche constitue la limite septentrionale de l’aire de répartition du Pic cendré, l’aire de répartition de l’espèce pourrait donc être en train de se restreindre.
La modification des pratiques sylvicoles (arrêt du taillis sous futaie, enrésinement, rajeunissement des vieilles futaies, abaissement de l’âge d’exploitation…) et la fragmentation des milieux forestiers lui sont défavorables. En Normandie, l’évolution des surfaces agricoles par la destruction du bocage, des bosquets et des forêts riveraines, ainsi que l’utilisation de pesticides réduisant les ressources en fourmis impactent particulièrement l’oiseau.
Pic mar
Le Pic mar est un représentant peu connu de la famille des pics : là encore, la faute à sa légendaire discrétion ! Il se manifeste cependant dès la fin de l’hiver par son chant plaintif et monotone – qui ressemble à… un cri de goret. Contrairement aux autres représentants de la famille des Picidés, ce petit pic ne tambourine pas pour marquer son territoire et n’utilise pour cela que sa voix.
On le retrouve majoritairement dans les forêts de vieux chênes dans lesquels il creuse sa loge pour nicher. Il trouve le vivre et le couvert dans le Perche où il a été contacté un peu partout. Espèce vivant sur un petit territoire, le Pic mar semble pouvoir se contenter des petits îlots de chênaies-charmaies vieillissantes.
Les menaces pesant sur cette espèce sont là encore les changements radicaux dans les méthodes d’exploitation forestière, comme le remplacement des peuplements feuillus par des résineux ainsi que l’abaissement de l’âge d’exploitation des arbres. De plus, l’exploitation en période de nidification, et dans une moindre mesure la transformation des taillis sous futaies en futaies régulières, lui sont également défavorables.
Pic noir
Il est le plus grand des pics européens, avec une envergure pouvant atteindre 75 cm. Le mâle possède une calotte rouge complète quand la femelle n’arbore de rouge que sur sa nuque. Le Pic noir a besoin d’un vaste territoire, de 350 à 800 hectares pour un couple, qu’il défend âprement. Il ne tolère aucun congénère en dehors de la période de reproduction, et même lors de la formation des couples en fin d’hiver, le mâle comme la femelle ont besoin d’un temps d’adaptation afin de se ré-apprivoiser.
Pendant la période de reproduction, il creuse sa loge dans un grand hêtre dominant de préférence, mais cela peut également être un vieux chêne ou dans la partie haute d’un pin. Une fois les jeunes envolés, chacun se sépare et retrouve son instinct asocial et les seuls contacts avec ses congénères se résumeront à quelques cris lointains.
Le Pic noir a connu une expansion fulgurante depuis les années 1950. Alors confiné aux forêts montagnardes, il a colonisé la quasi-totalité du territoire français depuis lors. Contacté plus rarement que le Pic mar (en raison de son vaste territoire) il semble néanmoins bien se porter dans le Perche. Mais la diminution de la présence du hêtre pourrait lui devenir préjudiciable car il apprécie cette essence à l’écorce lisse qui limite l’accès au nid par les prédateurs tels que la Martre des pins.
Busard Saint Martin
Cet oiseau vole souvent à faible hauteur en quête de nourriture. On le retrouve ainsi dans les champs, les prairies, friches, landes, coupes forestières… En France, l’espèce se reproduit essentiellement dans les cultures (blé et orge), friches, coupes forestières, landes, jeunes plantations de résineux, etc…
Les effectifs du Busard Saint-Martin ont subi une nette augmentation depuis les années 70 en France, passant de 1000 couples en 1976 à 13 000-22 000 en 2012. Cette tendance est peut-être due à un changement de stratégie de nidification de l’espèce suite à la disparition des habitats de nidification d’origine. Aujourd’hui, l'augmentation semble moins nette, avec des variations selon les régions (en diminution dans l’Orne).
La principale menace planant sur cette espèce est la fauche trop précoce. En effet, se trouvant au sol, le nid et les oisillons sont particulièrement vulnérables face aux machines agricoles et les pertes peuvent atteindre les 80% dans les milieux de cultures. La régression continue des friches et des prairies menace également la population hivernante.
Bondrée apivore
Ce rapace migrateur de la famille des aigles, buses, busards, etc. peut être confondu avec la Buse variable. Son régime alimentaire le distingue toutefois car il est friand de guêpes et bourdons, mais pas d’abeilles contrairement à ce que ce nom pourrait indiquer ! Il les chasse près du sol dans des terrains découverts et semi-boisés : le bocage est donc son environnement de prédilection.
La Bondrée est un oiseau migrateur strict qui passe la majeure partie de sa vie dans les forêts d’Afrique tropicale. Il arrive dans nos régions à partir de mi-mai et repart dès la fin de la reproduction début août. Ses mœurs relativement discrètes en font un rapace difficile à repérer, ce qui le préserve aussi des tirs illégaux que subissent certains rapaces, sauf dans certains pays en période de migration (Malte, Liban, Italie).
L’utilisation des insecticides peut en revanche avoir un effet négatif sur l’espèce en diminuant les ressources de nourriture. Les populations de Bondrée apivore semblent relativement stables en France. Il a ainsi été observé en plusieurs points dans le Perche ou l’espèce niche très certainement.
Cigogne noire
Deux individus de Cigogne noire ont été observés en même temps en halte sur un étang du Perche restauré dans le cadre de Natura 2000. Cette cousine méconnue de la Cigogne blanche reste très discrète, nichant de préférence dans les grandes forêts feuillues peu ou pas exploitées. La présence d’un réseau de ruisseaux, mares, étangs et autres zones humides intra ou extra-forestier lui est nécessaire. C’est une espèce qui nécessite une grande quiétude et le moindre dérangement en période de reproduction lui est néfaste.
Les effectifs sont encore très faibles et l’oiseau est considéré comme rare et en danger, aussi bien à l’échelle nationale qu’européenne. On estime la population nicheuse française à 40-60 couples seulement, menacés par l’exploitation forestière en période de nidification et la fréquentation humaine qui peuvent compromettre la réussite de la reproduction. La préservation des zones humides est indispensable pour lui assurer des zones d’alimentation. L’électrocution et la collision des oiseaux sur les lignes électriques sont aussi des facteurs de menace en Europe.
Spatule blanche
Ce grand échassier au plumage blanc dominant possède un bec noir en spatule caractéristique. Il se nourrit de petits poissons, amphibiens, insectes, arthropodes (écrevisses) et reptiles dans les milieux inondés ouverts tels que les marais doux ou saumâtres, les prairies humides, les bords des cours d’eau, des lacs, des étangs et les lagunes. Cet oiseau migrateur commence à partir dès le début du mois de juillet.
Il est rare dans le Perche, et les observations exceptionnelles concernent des individus en halte migratoire sur les étangs, comme celui observé en septembre dernier. Les populations de spatules restent vulnérables, tant pour les nicheurs que pour les hivernants plus à l’ouest et au sud. Toutefois, la mise en œuvre d’un réseau de sites protégés entre la France, les Pays-Bas et l’Espagne a permis d’accroître les populations de manière significative. L’augmentation des effectifs est aussi due aux mesures de protection de l’espèce ainsi qu’aux mesures de gestion/restauration des habitats en sa faveur.